Menu

Le botrytis est une maladie très redoutée par les viticulteurs du fait des dégâts qu’il provoque et de son incidence sur la qualité des vins. Le botrytis peut causer des pertes de rendement de l’ordre de 40%.
Sur les feuilles, le botrytis se caractérise par l’apparition de nécroses étalées donnant un aspect brûlé (feutrage gris par temps humide). Sur les rameaux, on observe des taches brunes qui blanchissent, des boursouflures apparaissent par la suite : les sclérotes. Les rameaux sont souvent contaminés par des blessures. Sur les grappes, des taches brunes apparaissent sur les inflorescences et sur la grappe en cours de maturation. Les fruits donnent un aspect pourri avec un développement d’une moisissure grisée. Le botrytis est visible à partir de la véraison et la contamination se développe par la création de nouveaux foyers à partir de foyers existants par des recoupements des fruits/feuilles.
Le développement de la maladie est fortement déterminé par les conditions météorologiques. Le botrytis produit un mycélium qui assurent une dissémination par l’intermédiaire du vent, des courants d’air et par les éclaboussures d’eau. La contamination s’effectue par contact. En conditions optimales, le cycle du botrytis est de l’ordre de 4 jours.
Les nécroses provoquées par le botrytis réduisent l’activité photosynthétique. Les dégâts sur les grappes sont caractérisés par une forte coulure et des pertes de rendement importantes. Le botrytis est également une maladie très préjudiciable à la qualité des vins, il dégrade la couleur, les arômes ainsi que la tenue au vieillissement. La présence de nécroses sur les feuilles n’a pas d’impact très important.

Le Black Rot est une maladie de la vigne dont les conséquences peuvent être considérables sur le rendement et la qualité du vin. La maladie touche aujourd’hui tous les vignobles.
Les attaques du Black Rot sont caractérisées par des petites taches circulaires grises de 0,2 à 1cm de diamètre. Avec le développement de la maladie, les tâches prennent l’aspect de feuilles mortes bordées par un liseré brun foncé. Des pustules noires appelées pycnides se forment à la périphérie des taches. Les pétioles peuvent également être touchés. Sur les rameaux, on observe des taches brunes allongées porteuses de spores. Sur les grappes, le black-rot se développe souvent après la floraison. La contamination des fruits est causée par les pycnides sur les feuilles. La sensibilité des grappes débute généralement après la floraison.
Le black-rot se conserve en hiver sur les baies contaminées tombées au sol ou sur les grappes non récoltées. Au printemps, avec les pluies, le black rot se développe et est responsable des contaminations primaires. La période d’incubation est de 7 à 25 jours selon les températures. Avec le développement de la maladie, des pycnides sont formés et sont responsables des contaminations secondaires. Le champignon a besoin de douceur et d’humidité, les conditions optimales à l’infection sont une durée d’humectation de 6 heures minimum et des températures comprises entre 9 et 32°C avec un optimum compris entre 20 et 25°C.
La présence de black rot sur les feuilles et rameaux n’induit pas de conséquences très importantes. Cependant, la contamination des grappes peut entraîner des pertes importantes pouvant aller jusqu’à 80% de la récolte. Des impacts sur la qualité du raisin sont également à prendre en compte comme la réduction de la couleur, un manque de fraîcheur et de nuances dans les arômes et goût plus sec.

L’oïdium de la vigne est une des maladies principales, les dégâts peuvent être très importants si les conditions météorologiques sont favorables ou avec une mauvaise protection. Cette maladie est présente dans tous les vignobles.
Sur les jeunes pousses, l’oïdium est caractérisé par un ralentissement de la croissance, d’un raccourcissement des entre nœuds et d’un flétrissement des feuilles. On peut voir un duvet blanc grisâtre apparaitre. Sur les feuilles, l’oïdium est visible par des tâches huileuses semblables à celles du mildiou. Les nervures noircissent sur les faces inférieures. Puis un feutrage gris apparait sur les faces supérieures des feuilles et les bords flétrissent. Sur les grappes, les fleurs contaminées se dessèchent puis tombent. Les grains se couvrent d’un feutrage blanc, puis par une poussière grisâtre et la peau éclate laissant voir les pépins. L’éclatement des fruits favorise l’écoulement du jus et favorise le développement du botrytis.
Le champignon se converse durant l’hiver sous deux formes : sexuée et asexuée. Sous la forme sexuée, il se conserve sous la forme de petits organes sphériques généralement sur les feuilles à partir de la fin de l’été et murissent en automne. A maturité au printemps, ils libèrent des spores. Sous la forme asexuée il se conserve sur les bourgeons infectés la saison précédente. L’oïdium se développe rapidement dès que les températures deviennent supérieures à 12°C (optimum vers 25°C) et quand l’humidité relative est comprise entre 40 et 100 %. En revanche, l’eau libre et la lumière gênent la germination des spores et le développement du mycélium.
Des pertes importantes de rendement peuvent avoir lieu. La qualité du vin peut également être dégradée avec des pertes d’arômes et de goût. Ces impacts ne peuvent pas être corrigés en cave. On constate également une diminution de la surface foliaire fonctionnelle, des problèmes de maturation, des éclatements puis dessèchements des grappes, des affaiblissements des ceps, un mauvais aoutement des bois…

Le mildiou est une des principales maladies de la vigne. Si la protection n’est pas suffisante, les dégâts peuvent provoquer une destruction totale de la récolte.
Sur les feuilles, on peut remarquer des tâches jaunâtres (que l’on appelle tâche d’huile). Le mildiou provoque une diminution de la surface foliaire de la vigne et donc une baisse de l’activité photosynthétique. Sur les rameaux, le mildiou conduira à la formation de rameaux de petite taille et rendra la taille plus délicate en hiver. Sur les grappes, le mildiou provoque des symptômes différents selon les stades d’infection. Avant la floraison de la vigne, on remarquera une “coulure” qui se traduit par un dessèchement des boutons floraux. Lorsque l’infection a lieu avant le stade de fermeture de la grappe, on peut voir l’apparition d’un feutrage blanchâtre sur les fruits. Puis, les attaques tardives, les fruits prennent une couleur brun-rouge et se dessèchent. Lors des attaques tardives, le mycélium est déjà présent dans les rafles ou le mildiou peut s’y développer.
Au cours de l’hiver, le mildiou se conserve sur les feuilles attaquées à l’automne et celles tombées au sol. Les œufs (oospores) de mildiou sont très résistants au froid (jusqu’à -20°C). La conservation du mildiou est favorisée par l’abondance de pluie. Puis les oeufs se développent au printemps, les conditions favorables à leur développement sont un printemps doux et pluvieux. Les œufs germent dans l’eau à partir d’une température moyenne de 12°C. Lorsque les températures atteignent 20 à 25°C, les oeufs sont expulsés et provoquent des contaminations primaires. La période d’incubation se situe entre 7 et 14 jours en fonction des conditions météorologiques.
Le mildiou provoque une diminution du remplissage des raisins en cours de maturation et une diminution de la mise en réserve dans les bois.
Afin de limiter les contaminations primaires, il est fortement conseillé de retirés ou d’enfouir de la parcelle les rameaux, feuilles et grappes desséchés au sol. Les souches non productives peuvent également être retirées.
Certains cépages se révèleront plus sensibles que d’autres aux maladies. Il faut donc veiller à bien choisir son cépage en cas de parcelles sensibles
Les pratiques de désherbage des vignes s’orientent aujourd’hui vers des techniques raisonnées. Avec le retrait de nombreuses matières actives (simazine, terbuthylazine, diuron, oryzalin) et les limitations d’usages (glyphosate), il est indispensable de construire des stratégies combinant désherbage chimique, mécanique et enherbement.
La nouvelle stratégie de désherbage chimique consiste à appliquer un herbicide sous le rang de vigne. La diminution de la largeur désherbée permet de réduire la consommation d’intrants.
Le désherbage mécanique consiste à détruire les adventices dans l’inter rang par un travail superficiel du sol. Les avantages du travail du sol sont d’économiser des intrants, d’aérer le sol, de restructurer les 10 premiers cm et donc de limiter le tassement.
Le désherbage par tâche consiste à appliquer un herbicide uniquement là ou les adventices sont présentes.
L’enherbement de l’inter rang de la vigne peut être réalisé un rang sur deux ou la totalité. Il peut être temporaire ou permanent. L’enherbement présente de nombreux avantages comme une amélioration de la portance et de l’infiltration de l’eau dans le sol, une diminution de l’érosion, un apport de matière organique, un décompactage naturel grâce aux racines des couverts.


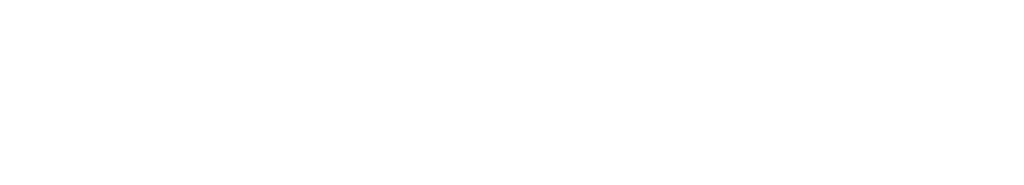
Tour Carpe Diem
31, place des Corolles
92400 Courbevoie – France
Tél. : 02 41 83 42 42
© Phyteurop 2024. Tous droits réservés.